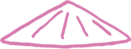Cette rubrique est destinée aux documents (images et textes) qui ne sont pas liés à un film, ou à un article particulier.
Pour un usage raisonné des médias
Nouvelle Revue Pédagogique, numéro 68, janvier 2016
Propos recueillis par Claire Beilin-Bourgeois
Qu’est-ce qui vous fait le plus réagir, aujourd’hui dans le traitement de l’information par les grands médias ?
Pierre Carles : C’est toujours frappant d’observer l’alignement des grands médias sur le pouvoir politique, comme lors des attentats de novembre dernier à Paris où seuls les discours ultra-sécuritaires et guerriers comme celui du premier ministre et du président de la République avaient droit de cité à l’antenne. Quand ce n’est pas en propagandiste du pouvoir politique, c’est en véritables portes-paroles du pouvoir économique que se comportent ces grands médias. En témoigne l’épisode de la chemise déchirée du directeur des ressources humaines d’Air France diffusée en octobre 2015. Cette image a été surmédiatisée et présentée comme la preuve d’une inacceptable brutalité exercée par des syndicalistes à l’égard de dirigeants d’entreprise. En mettant la lumière sur ce vêtement déchiré, en surexposant la scène du DRH torse nu, on laisse de fait dans l’ombre la violence exercée par les patrons d’entreprises, notamment ceux de sociétés dégageant d’importants bénéfices comme le groupe Air France/KLM, lorsqu’ils réduisent massivement leurs effectifs. Cette violence-là touche plus de monde, fait bien plus de dégâts, mais elle est moins spectaculaire, bien plus invisible. Les caméras sont rarement là pour filmer les divorces, la consommation excessive d’alcool et de médicaments, les dépressions, sans parler des suicides qui frappent les salariés licenciés. Ce qui est terrible aussi c’est le discours a-historique et a-sociologique des grands médias : c’est rare qu’ils situent les événements qu’ils couvrent dans une perspective historique, qu’ils rappellent que ce qui se passe aujourd’hui ne vient pas de nulle part, a une histoire. Ils mettent rarement en évidence les liens de cause à effet qui expliquent les comportements des agents sociaux, comme nous y incite par exemple la sociologie. Un exemple : en l’état actuel, on sait que les prisons françaises, peuplées majoritairement de pauvres, sont criminogènes et ne luttent pas contre les phénomènes de récidive, au contraire. Dans les principaux médias, on continue pourtant de laisser entendre qu’enfermer de plus en plus de gens en prison, y compris dans des conditions de surpopulation carcérale ou avec des conditions de détention inhumaines n’est pas un problème, au contraire. Même chose pour les politiques d’austérité néo-libérales : on a beau savoir quels effets néfastes elles produisent, notamment en terme d’augmentation des inégalités sociales, on continue d’en faire l’article dans les principaux médias. En revanche, le mot « nationalisation » est absent, lui, du vocabulaire des responsables de l’information quand il n’est pas raillé ou dénigré. On n’a pas vu apparaître, dans les émissions dites de « débat » sur le petit écran, une discussion sur l’éventualité de nationaliser les autoroutes françaises lorsqu’on a découvert, fin 2014, les profits faramineux ou excessifs que faisaient les sociétés autoroutières. Tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des idées communistes, à des pratiques collectivistes, est banni de l’antenne.
Voyez-vous une différence de nature entre les chaînes d’information continue et les autres ? Les premières imposent-elles plus de prudence dans leur lecture ?
P. C. : Non, il n’y a pas de grandes différences. Les chaînes d’« information continue », les chaînes généralistes et certains sites internet donnent le « la ». Les autres médias suivent et alimentent de la sorte, à leur tour, cette « musique » qui ne dit pas son nom, le discours ambiant pro-néolibéral et anti-communiste (ou pro-étasunien en matière de couverture de ce qui se passe à l’étranger). Ces grands médias – je ne parle pas là de la presse écrite où il subsiste encore quelques journaux véritablement indépendants mais relativement marginaux en terme d’audience – tombent la plupart du temps dans le registre de l’émotion plutôt que dans celui de la réflexion et la raison. Ils font un travail de communication gouvernementale ou entrepreneuriale et ne pratiquent pas l’enquête sociale. Or c’est l’enquête au long cours sur le monde social, la révélation des différentes formes que peuvent prendre les relations de domination dans notre société – comment les pauvres sont dominés par les riches, comment les femmes le sont par les hommes, comment la province est dominée par Paris, comme les détenteurs d’un fort capital culturel prennent le dessus sur ceux qui en possèdent peu… – qui constituent ce que devrait être l’information au sens noble du terme.
Peut-on apprendre (et enseigner) à lire les medias comme le demandent les instructions officielles de l’Éducation Nationale ?
P. C. : Peut-être faudrait-il commencer par enseigner la sociologie critique ou la sociologie tout court, notamment celle développée par Émile Durkheim, Karl Marx ou Pierre Bourdieu. Sans oublier l’histoire, mais plutôt celle du « Manuel d’histoire critique » édité par Le Monde diplomatique que celle des manuels scolaires qui minimisent le rôle joué par l’URSS dans la défaite de l’Allemagne nazie et surévaluent celui des USA. Ces deux matières sont de très bons outils de « self-défense ». Elles devraient permettent aux jeunes et au moins jeunes de combattre la propagande des grands médias à faveur de tels ou tels dominants ou puissants.
Vos films décodent l’information, en présentent une grille de lecture. Lesquels peuvent être des outils pour les enseignants ? Un format vous paraît-il plus adapté qu’un autre ?
P. C : Juppé, forcément… (1995) et Hollande, DSK, etc. (2012, coréalisé avec Julien Brygo, Nina Faure et Aurore Van Opstal) pourraient servir. Ou bien La Sociologie est un sport de combat (2001). On peut aussi recommander Noam Chomsky. Les médias et les illusions nécessaires, de Mark Achbar et Peter Wintonick (1993) et Les nouveaux chiens de garde de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat (2012), inspiré du livre du même nom de Serge Halimi.
Dans Les ânes ont soif, vous faites des focus saisissants entre différents types de journalistes : les journalistes ne devraient-ils pas, justement exposer de manière plus explicite leurs méthodes et leurs points de vue, au lieu de feindre l’objectivité ?
P.C. : Oui. Et signaler d’où ils parlent. Les responsables de l’information ne nous indiquent que rarement leur position sociale et économique. Or, ils relatent ce qui se passe dans cette société depuis un point de vue qui est d’abord et avant tout celui d’individus qui ne partagent pas le quotidien de la majorité des Français. Leur vision du monde est souvent celle des élites médiatiques, politiques et économiques. La plupart du temps, c’est le point de vue de la haute bourgeoise française qu’ils colportent. Or celle-ci – on la comprend – n’a aucune envie que les choses changent. Ils ne souhaitent pas que survienne une révolution dans ce pays ou sur la planète qui menacerait leurs positions de pouvoir. Quel intérêt aurait-il à cela ? Ils sont foncièrement conservateurs ou du moins anti-révolutionnaires.
En apprenant aux gens à être prudents, à ne pas se laisser prendre à la manipulation ou aux manques de l’information des medias de masse, ne risque-t-on pas de les voir devenir méfiants, et du coup de se laisser prendre aux thèses farfelues qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux ?
P.C. : Là encore, la sociologie constitue le meilleur antidote. Un exemple ? Après les massacres du 13 novembre 2015 au Bataclan et sur les terrasses de café des 10e et 11e arrondissement de Paris, on parlé dans certains médias d’une attaque contre « la » jeunesse de France. Or c’est faux. Si l’on avait lu Pierre Bourdieu on saurait que « la jeunesse n’est qu’un mot », comme l’expliquait ce dernier dans un entretien avec Anne-Marie Métailié [1] : « Le fait de parler des jeunes comme d’une unité sociale, d’un groupe constitué, doté d’intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente. Il faudrait au moins analyser les différences entre les jeunesses, ou, pour aller vite, entre les deux jeunesses. Par exemple, on pourrait comparer systématiquement les conditions d’existence, le marché du travail, le budget temps, etc., des “jeunes” qui sont déjà au travail, et des adolescents du même âge (biologique) qui sont étudiants : d’un côté, les contraintes, à peine atténuées par la solidarité familiale, de l’univers économique réel, de l’autre, les facilités d’une économie quasi ludique d’assistés, fondée sur la subvention, avec repas et logement à bas prix, titres d’accès à prix réduits au théâtre et au cinéma, etc ». Ce texte date de 1978. Trente sept ans plus tard, il faut juste remplacer « des jeunes qui sont déjà au travail » par « des jeunes qui sont au chômage » (ceux des classes populaires). Et Bourdieu disait aussi à propos de inégalités sociales : « Dans un cas, on a un univers d’adolescence, au sens vrai, c’est-à-dire d’irresponsabilité provisoire : ces “jeunes” sont dans une sorte de no man’s land social, ils sont adultes pour certaines choses, ils sont enfants pour d’autres, ils jouent sur les deux tableaux. » Bref, il distinguait d’un côté l’éternel étudiant, bourgeois ou petit-bourgeois ; de l’autre le jeune habitant d’un quartier ouvrier en déclin qui n’a pas eu d’adolescence (au sens où on l’entend dans les milieux favorisés). Il n’est jamais inutile de rappeler que nous vivons dans une société traversée par la lutte des classes et les relations de domination. Cela, il ne faut jamais le perdre de vue.
[1] Paru dans Les jeunes et le premier emploi, Paris, Association des Ages, 1978, p. 520-530. Repris in Questions de sociologie, Éditions de Minuit, 1984. Ed. 1992 p.143-154.